Cette page est destinée à recueillir les souvenirs et les impressions des habitants de Joch. Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs et impliquent l’acceptation et le respect de la charte éditoriale détaillée ici.
L’hiver à Joch
2023. En ces derniers jours de janvier à Joch : neige, verglas puis tramontane … Gérard Gensane écrit:
« On le croit fait d’été et de soleil, notre village, d’eau claire à boire goulûment quand la sueur colle à la peau, de bruits qui n’en finissent plus de s’endormir quand la première étoile chasse un soleil qui s’évanouit épuisé, notre village qui semble fait pour brûler par les deux bouts sa vie passionnée le temps d’un été brûlant.
Et pourtant le connaissez vous, l’hiver, quand la tramontane se hâte de balayer des journées qui lui échappent, quand le soleil oublie des ruelles que l’ombre a faites siennes ? Le connaissez-vous quand nous sommes entre nous, heureux d’une rencontre si rare et si précieuse quand on a enfin le temps de perdre son temps, quand le bois qu’on rentre a déjà le goût de la flamme qui va le dévorer, au fond d’une cheminée sans âge ?
Le connaissez-vous quand le salt du rec major chante sa vigueur retrouvée comme l’oiseau gonflé de plumes que la neige ne surprend plus ?
Le connaissez-vous quand les dernières noix sont tombées et les premières pommes sont ridées ? Quand le sanglier est aux abois et que les glands jouent aux billes sur nos sentiers ? Alors le jambon est de saison et le temps, épuisé d’être si court, fait une longue pause au bord du feu. Alors je ne sais plus si Joch existe, ou si je l’ai inventé. »
Avons-nous connu la peste noire à Joch au XVII° ?
Article de Gérard GENSANE (avril 2022)
Oui notre village, si l’on en croit les archives paroissiales, en a été victime au moins de 1647 à 1652.
En effet de 1347 à 1666, la peste a été le plus terrible fléau qui ait affligé l’Europe. Spontanément, ce mal, qui fait presque inexorablement passer de vie à trépas quiconque en est atteint, entraîne des comportements individuels et collectifs guidés par la peur.
A l’âge classique pourtant, instruits par trois siècles de cruelle expérience, les hommes ne se sentent pas totalement démunis face à l’épidémie : pour s’en préserver dans un premier temps, pour en limiter les effets dévastateurs ensuite, ils tentent désespérément de dépasser les réflexes primaires de panique, générateurs d’anarchie, pour imposer des mesures d’exception salvatrices. A Joch par exemple j’ai pu m’apercevoir que de nombreux habitants étaient allés mourir dans des vignes ou des bois à l’écart de notre village. Car cette terrifiante pandémie fut une effroyable tragédie.
En 1645, elle atteint Bordeaux et y reste jusqu’en 1648. En 1649, la Catalogne et Marseille sont frappées à leur tour. En 1650, on la diagnostique à Limoux et, en novembre 1651, à Toulouse puis le Bas-Languedoc (Castelnaudary, Carcassonne, Narbonne, Béziers…) et le Rouergue. La contagion et sa traîne de malheurs affligent la région jusqu’à l’hiver 1654-1655. Les Pyrénées centrales et leur piémont furent particulièrement affectés.
Transportée par un marchand malade, elle se répand rapidement dans nos vallées Une hécatombe pour les communautés touchées – La première des conséquences démographiques de la peste – la plus spectaculaire et la plus douloureuse – est la soudaine augmentation de la mortalité. Joch, pourtant à l’écart des routes commerciales, se met à enterrer ses morts. Sur le registre des décès le prêtre indique souvent le lieu où le corps a été retrouvé et surtout les précautions à prendre car il est « contagi », c’est-à-dire contagieux.
J’ai pu relever pour octobre 1647 le décès « d’un jove incognit en la serra de Joc ». Il était donc allé, de gré ou de force, agoniser dans la montagne. Les années suivantes furent sans doute terribles car en Août 1651 décède de peste Francisca Terris âgée d’un an, puis en décembre 1652 on retrouve son père, March Terris, « cerca del torrent del Coll », encore dans la montagne, avec la mention « contagi ». Le 15 décembre c’est Joan Carlos Terris, fils de March qui est retrouvé avec « sospita de contagi ». Le 25 décembre ce fut le corps de Jaume Laffont, fill, « cerca barraca de la vinya de Miquel Boera », lui aussi contagi. Deux mois plus tard en janvier 1653, ce fut le corps de Monferrada Laffont, « en la vinya de Miquel Daniel » avec la mention « sospita de contagi », donc suspicion de contagion. Le même mois on retrouva Jaume Terris, « en la vinya de Jaume Gensane dita font llonga », lui aussi avec «sospita de contagi ».
On voit donc que ces deux familles Terris et Laffont ont payé un lourd tribut à l’épidémie et que leurs morts sont allés s’éteindre cachés entre les vignes qui n’étaient guère fréquentées en hiver et où ils ont été ensevelis pour les éloigner des villageois. Et combien de corps n’ont pas été ramenés au village par peur de la contagion, ce terrible « sospita de contagi » qui a dû faire trembler notre paisible village dans ces années de peste noire?
De Vinça à Joch, un kilomètre mesure-t-il toujours un kilomètre ?
Article de Gérard GENSANE (novembre 2021)
Depuis quelques dizaines années une invraisemblable question dérange mes méninges : les kilomètres ont-ils aujourd’hui la même longueur qu’il y a 70 ans ? Quand je quitte Vinça au volant de mon automobile je suis au pied de Joch en quelques minutes.
Suis-je bien passé par le Casot de Batistou, par le Mas d’en Rubi, par els Quatre-Sants et la Couloumine ? Tous ces lieux connus de tous marquaient des repères sur cette route que les charrettes et quelques lourdes bicyclettes, quand on n’allait pas à pied, empruntaient sur les 4 km séparant notre village de Vinça, la capitale, où tout s’achetait et se vendait.Autant de repères dans le temps pour évaluer la durée du trajet et surtout dans l’espace pour se situer.
Peu après le Camp Gran il y avait le Casot de Batistou, à gauche, qui marquait le partidou : les eaux s’y divisaient pour irriguer les champs de Finestret, Vinça et Rigarda. On y franchissait le Cami de l’Estrade, cette vénérable Strada romaine qui 2000 ans plus tôt reliait Perpignan la Méditerranéenne à Saillagouse la Cerdane.
Puis venait, après une traversée de vergers opulents, le bastion du Mas d’en Rubi à droite avec ses 3 bâtiments agricoles, enserrant d’étroites habitations et où nichait un Saint-Jean au vieux bois éreinté par les ans.
Enfin, comme pour répondre à la question qu’on se pose à chaque carrefour, à ma droite un Oratoire à quatre faces avec sur chacune d’elle une niche abritant la statuette d’un Saint. Mais aucun n’avait été choisi au hasard.

- Regardant vers Joch et le sud, Saint Martin au manteau rutilant.
- Regardant vers Finestret et l’ouest, Sainte Colombe avec un ours à ses pieds.
- Regardant vers le nord et Sahorle, Sainte Madeleine et sa féminité sacrée.
- Enfin regardant vers Rigarda et l’est, Sainte Eulalie tenant la palme du martyre.
Chacun de ces personnages sacrés est le saint patron du village qu’il regarde et le voyageur ne peut donc se tromper de route. Il suffit ensuite de passer devant la Couloumine à gauche pour savoir que nous sommes au pied de Joch et que l’écurie n’est pas loin, juste après le pont de Sant Marti qui nous ouvre le paradis !
Aujourd’hui mon trajet occupe mes trois premières lignes. Autrefois il me fallait les vingt lignes suivantes pour que ma charrette arrive au cortal. Bien sûr j’ai mis plus de temps, mais au moins je n’ai rien raté.
Les ors de Joch
Article de Gérard GENSANE (mai 2021)
Pourquoi, dans l’église de Joch, plusieurs retables du maître Joseph Sunyer ?
L’ancienne église de Joch était située près du cimetière et fort éloignée du village, au bord du ravin San Marti. C’était une chapelle romane dédiée à Saint-Martin qui dépendait dès 1151 du prieuré de Serrabona et possédait une crypte où furent enterrés les seigneurs de la Baronnie. Jugée sans doute trop petite et surtout trop éloignée du village elle fut remplacée au cours du XVIIIe siècle par l’église actuelle, grâce notamment à la Comtesse d’Aranda, vicomtesse de Joc, qui avait offert alguna lliberalitat pour cette construction.
Aujourd’hui les visiteurs sont éblouis par la richesse du patrimoine mobilier baroque des quatre chapelles majeures et du maître-autel. Dès que l’on a fait un pas dans ce lieu sacré, les ors et les couleurs du Baroque catalan éclatent de toutes parts. Tous les bois sont dorés à la feuille d’or et le maître autel notamment semble flamboyer au bout de la nef. Mais ce qui est plus merveilleux c’est la fierté d’être de Joch et de savoir que ces retables somptueux proviennent de l’ancienne église. Cette église romane, à laquelle le village a renoncé, a non seulement donné ses pierres, passées de main en main, pour construire la nouvelle, mais aussi au moins trois retables qui s’avèrent être l’œuvre du plus grand artiste baroque, Joseph Sunyer. Comment notre modeste village a-t-il pu s’offrir le concours d’un artiste que tout le pays catalan s’est disputé et dont les œuvres majeures se trouvent dans des communes mille fois plus riches que la nôtre comme Prades, Collioure, Vinça ou Font-Romeu ?
Né dans une famille de sculpteurs en Espagne, à Manresa, Sunyer arrive à Perpignan en 1696 et aussitôt on s’arrache le talent de cet homme porteur de nombreuses innovations dans le domaine de la sculpture, inspiré par l’œuvre du Bernin à Rome et notamment au Vatican. Or notre retable de Saint Jean Baptiste est de 1698. Sunyer vient donc d’arriver en France et Joch a reconnu le talent de ce jeune homme qui n’a pas 25 ans et va exprimer dans son église une imagination chaude et luxuriante. Ce retable évoque en quatre panneaux encadrant une statue du Baptiste, des scènes de sa vie et notamment celle où il reçoit son nom. La fougue de Sunyer maîtrise la correction des attitudes et l’harmonie des proportions dans le geste de la mère, Elisabeth, qui depuis son lit, de son index significativement tendu vers Zacharie le père, lui indique où il devra inscrire le nom de Jean le Baptiste. Sunyer sait que Zacharie est muet et qu’il devra pourtant indiquer à tous le nom de son fils, au sixième jour, celui de la circoncision. Alors il le représente dans une vérité étonnante, assis humblement sur un escabeau, au pied du lit d’Elisabeth qui domine impérieusement toute la scène sous son baldaquin de brocard bleu. Zacharie écrit avec application sous la dictée de sa femme sur un support qu’il va tourner vers nous pour que nous lisions « Jean, c’est son nom ». Nous voilà immergés dans la scène, aspirés par la force de Sunyer qui nous fait attendre avidement de lire le nom, dans le silence, puisque Zacharie est muet. Dans cette atmosphère hors du temps, les ors du décor et les fulgurances chatoyantes des draperies comme des vêtements illuminent cette scène que nous partageons nous aussi. A chaque visite de l’église de Joch, la magie opère car la force de Sunyer porte ce mouvement des personnages, vigoureux et léger mais d’une solennité digne. Je me demande, à chaque fois, comment nous avons pu doter notre modeste église romane d’un pareil chef-d’œuvre il y a plus de trois siècles et avoir deviné le talent fou de cet homme.
Il est tout aussi original et fécond dans son art de saisir une scène, comme un instantané photographique, lorsque sur le même retable il évoque la décollation du Baptiste. Il ne nous montre pas comme d’autres la décapitation mais l’instant où Salomé apparaît avec la tête de Jean sur un plateau d’argent, obtenue grâce à sa danse envoûtante. En contreplongée le cou sanguinolent et le corps blafard du saint s’écoulent vers nous et nous font entrer dans cette scène terrible. Nous en sommes devenus d’effroyables spectateurs alors qu’Hérode qui l’a voulue est honteusement loin, en haut à droite, assis sur un trône dérisoire. Son pendant à gauche est le soldat et le couteau qui ont fait le geste fatal. Nous n’avons rien pu faire, le Baptiste vient d’expirer devant nous et ses yeux nous regardent avec la fixité du martyre.
Nos aïeux ont-ils été sensibles, dès cette époque, à cette rupture avec l’académisme et à la moindre passion de Sunyer pour l’antique païen ? En tout cas en 1728, c’est-à-dire 30 ans plus tard, Sunyer reviendra à Joch pour le retable majeur de notre modeste église romane, dédié à Saint Martin. Il était assez normal que notre village, juché sur un éperon dominant la plaine de la Baronnie, soit consacré à un homme porteur d’un tel prénom dérivé du dieu Mars, divinité de la guerre chez les Romains. Mais le soldat païen s’était converti au christianisme pour devenir finalement évêque de Tours et c’est cette figure que Sunyer met au centre de l’iconographie de cet immense retable qui éclabousse de ses ors toute l’église et qui vous éblouit dès que vous y pénétrez. Mais le génie du maître éclate dans sa façon de suspendre dans le retable inondé de couleurs, des anges semblables à ceux du Bernin, avec leurs jambes nues qui dansent dans le vide dominant toutes les scènes inférieures. A peine posés sur des ressauts étroits ils semblent flotter dans leur espace donnant une étonnante respiration aérienne à l’œuvre. C’est comme un décor de théâtre où la religion met en scène des anges asexués et à peine vêtus dont les cuisses légères et roses échappant à leur cadre doré, nous invitent à une sarabande presque sensuelle.
L’esprit de réforme de l’Eglise, répandu après le Concile de Trente, souffle sur les visages et les corps sculptés par Sunyer. Voilà ce qu’en quelques années il a maîtrisé, parcourant un itinéraire magistralement illustré dans notre église entre le retable de ses débuts en 1698 et celui de sa maturité en 1728. Entre ces deux dates c’est Prades ou Collioure qui l’ont rendu célèbre avec leurs retables qui rappellent Saint Pierre de Rome, car qui connaissait Joch, à cette époque……comme aujourd’hui d’ailleurs ?
Mais le plus extraordinaire c’est que ces chefs d’œuvre, réalisés pour l’église primitive romane, ont trouvé leur place dans la nouvelle construite pour les abriter. Les pauvres maçons du XVIII° siècle ont bâti à leur taille l’écrin de ces retables précieux. Démontés et remontés un peu plus haut dans le village, les retables ont trouvé une architecture pour les protéger et se sont endormi dans une indifférence pieuse. Mais les visiteurs d’aujourd’hui que l’art de Sunyer a attirés dans le pays catalan, les réveillent lentement. Dans la grande nuit des églises fermées, celle de Joch s’ouvre sur les ors et la flamboyance d’un artiste majeur.
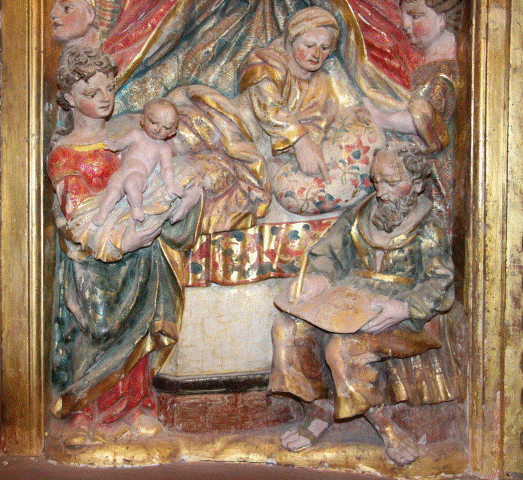

La « casa de la Maria Maler »
Interview de Jacques MALER (mai 2021)
La « casa de la Maria Maler » est située au numéro 25 du Carrer Major, presque en face du lavoir, juste après la maison natale de Francesc Català. Elle s’étage depuis le Carrer Major jusqu’au « rec d’Avall », au bas des cascades. Vous la reconnaîtrez à son petit panneau vous invitant à la visiter. Si Jacques MALER, l’actuel maître des lieux, est présent, n’y manquez pas, vous ne regretterez pas votre visite.
En effet, Jacques Maler, a d’une part collectionné des souvenirs insolites et d’autre part a su décorer sa maison en artiste qu’il est. Vous pourrez y voyager jusqu’en Amérique sur les traces des caravelles de Christophe Colomb, ou aussi bien admirer une fresque au gré des vents, du xaloc à la tramontane et du gregal au canigonenc.
Et bien d’autres choses à découvrir encore.



La casa païral
Article de Gérard GENSANE (mars 2021).
J’ai la chance d’habiter à Joch la maison de village de mes ancêtres, la casa païral où le cellier et l’écurie sont intacts, où le tombereau est devant l’étable, où le bois est à sa place et où le jacuzzi est resté chez Leroy-Merlin.
Tous ces bâtiments bien regroupés avaient ainsi économisé la terre cultivable et nourricière sur laquelle personne n’aurait osé construire. Ils sont au centre du village un élément de polarisation de l’habitat et des structures économiques. Voilà pourquoi des maisons comme la mienne sont un peu compliquées à comprendre même si nous nous sommes efforcés d’éliminer à l’intérieur trappes, escaliers raides et chausse-trappes pour changer d’étage ! Des ouvertures dans le toit permettent aujourd’hui de donner la lumière à ces cambres fousques (chambres obscures) où dormaient les vieux qui n’avaient plus besoin d’aller travailler dans les champs.
Avec l’arrivée de l’eau courante dans toutes les maisons à la fin des années cinquante, le robinet a relégué sous l’évier le broc qui contenait toujours une réserve d’eau puisée à la fontaine. Mais la cuisine est restée la grande pièce à vivre. La salle à manger que dans toutes les maisons on appelle inévitablement « la salle », tournée vers le nord avec son unique fenêtre, n’accueillait que quelques repas par an : un pour Sainte-Marie le 15 août, un le jour de Noël, trois pour la Saint Martin fête de Joch , quatre pour tuer le cochon. Et c’est tout pour cette grande pièce peu fréquentée et mal chauffée, si ce n’est par l’ambiance ces jours-là !
La cuisine était l’âme de la maison avec sa grande table rectangulaire au milieu qui permettait de rendre évidentes les 2 places réservées. Une au bout pour le chef de famille, qui gère l’exploitation agricole et les finances, l’autre place à l’autre bout pour la cuisinière, c’est-à-dire la grand-mère. Dans un angle le four à pain ouvrait sa gueule sombre tandis qu’il se poursuivait à l’extérieur par un joli dos arrondi couvert d’un toit de lauses qui faisait saillie dans la rue. La large pelle de bois pour enfourner et le long pétrin (la « pastera ») complétaient le mobilier car les placards pour la vaisselle et les provisions étaient de grandes niches logées dans les murs. Leurs étagères habillées de dentelle égayaient les murs sans en faire trop tant leurs motifs discrets et blancs étaient les seules fantaisies qu’on pouvait imaginer dans ces maisons où le travail était le décor naturel. Enfin la grande cheminée était le point d’ancrage de la vie de la maison avec son âtre toujours actif, une « olla » (marmite) suspendue à la crémaillère où cuisaient les patates pour les cochons et une autre plus grande sur un trépied, emplie d’eau toujours à disposition pour la toilette des enfants à l’eau chaude. Deux bancs en bois de chaque côté (« l’escón ») étaient réservés aux plus âgés avec leurs coussins aux housses tricotées à la main dans une laine vaguement rose. C’était l’espace des longues soirées où l’on égrenait le maïs ou les haricots tandis que derrière nous on jouait aux cartes catalanes. C’était le moment des bûches crépitant d’allégresse, heureuses de nous éblouir de leurs flammes. Dans la journée, dans la cuisine vide, c’était le moment des 2 troncs d’arbre qui rejoignaient leur tête dans l’âtre rougeoyant et que grand-mère poussait de temps en temps comme une blanche vestale romaine qui se serait habillée de noir. Pour s’éclairer, l’inévitable abat-jour en émail blanc renvoyait la lumière comme une assiette renversée.
Mais cet univers en noir et blanc n’était jamais triste car il y avait toujours des irruptions de voisines pour égayer ce monde sans radio ni télévision. La téléspectatrice moyenne de 50 ans n’était que l’acheteuse improbable de biens dont elle n’avait pas besoin ni même connaissance. La vie d’aujourd’hui ne facilite guère la survie du modèle ancien et conjuguer le confort moderne avec mon souci de garder à la maison son âme et sa respiration, demande un tact et une prudence que nous nous efforçons de manier avec respect.
Faire construire dans la plaine une maison sur une parcelle arrachée à une vigne qu’on ne cultive plus, offre plus de possibilités et moins de contraintes. Pourtant où loger la pastera et sa longue pelle en bois ? Et la charrette toujours peinte en bleu pour éloigner les mouches ? Cela aurait-il un sens d’insérer dans la façade ces bouts de cayrou rouge ? Non, à chacun son univers avec son charme respectif. Ma maison tarabiscotée est coincée entre deux autres depuis 400 ans, son jardin potager est à l’autre bout du village sur le Camí dels horts, mais la cave creusée dans la roche dont la température est toujours la même hiver comme été précède la bergerie et le fenil. En dessous l’écurie, sa « gripi » (la mangeoire), son râtelier et ses harnais de cuir, son fouet en bois de micocoulier et ses charrues amovibles, et devant la porte « el roc de batre » doucement cylindrique pour mieux tourner en rond malgré ses 900 kilos sur l’aire à dépiquer.
Comme la mienne des dizaines de ces maisons dites « de village » s’égrènent dans Joch, avec leur respiration d’autrefois, leur teint fatigué, leurs insolites ferrures dentées aux fenêtres sans volets (les esquixe-calces forgées à la main), leur inadaptation à la vie moderne, sans garage ni balançoire, sans volets électriques ni barbecues.
Et je me dis qu’au moins si Eléonore la Dame Blanche, ou Pierre de Pèrepertusa ou plus simplement la bruixa, la Pailleverda, ma voisine reviennent, ils trouveront leur place et sauront où mettre escarpins ou sabots.
El rentador del cementiri
Article de Marie-José FABRESSE (novembre 2020)
Plongée dans l’oubli depuis de longues années et extirpée de sa prison végétale par un enfant de Joch, revoilà notre vieille « font del cementiri » qui renait à la vie tout doucement. Cette résurrection a éveillé en moi un souvenir d’enfance parmi les plus doux.
Depuis la fontaine, remontez le chemin. Quelques foulées plus haut, sur votre droite, là où coule un vaillant ruisseau, à cet endroit bien précis dans ma mémoire, trônait un « rentador » (lavoir) avec ses margelles de « lloses ».
C’est là qu’enfant, accompagnée par Mémé Julie, je venais laver notre linge.
« L’ avia », malgré son apparence gracile, ressemblait à un pied de vigne en hiver (dans toute sa noblesse) : de noir vêtue, noueuse, sèche, mais rude à la tâche comme tous les catalans de ces temps anciens. Ses yeux d’un bleu limpide et ses cheveux d’un blanc immaculé, coiffés en chignon sous un foulard noir, la rendaient, à mes yeux de petite fille, la plus adorable des grand-mères.
Le jour venu, elle me lançait d’un ton résolu : « Nina, anem a rentar ». C’est elle qui portait les charges les plus lourdes, le plus souvent entassées sur la vieille brouette qui n’en finissait pas de gémir : le « caixó » ou « agenollador »(baquet ou agenouilloir où elle posait un sac en toile de jute « plegat en quatre » comme elle le disait si bien afin de protéger ses genoux) et la « banasta » de linge sale.
Mémé Julie me confiait la lourde responsabilité de m’occuper du transport du « raspall » ( brosse en racines de chiendent séchées), la « »pedra de sabó » (pierre de savon) et le « batador » (battoir en bois).
Ces souvenirs, si émouvants pour moi et ceux de ma génération, apparaîtront bien dérisoires et anodins aux yeux des plus jeunes. Pour s’émouvoir de cette enfance il faut l’avoir vécue ! Enfance dans mon petit village de Joch où j’ai toujours mes racines les plus profondes, dans un monde où régnaient l’insouciance et un art de vivre au plus près des gens et de la nature……La vie tout simplement ! Ce monde que je regrette chaque jour un peu plus.
